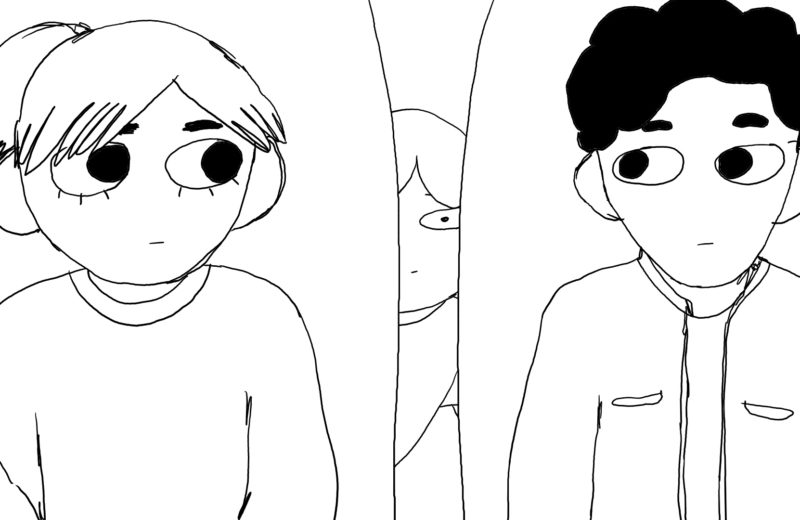L’histoire commence par une bicoque improvisée par Gérard Capazza dans un chemin sans issue, en 1975. Elle se poursuit grâce à l’idéalisme d’une jeune fille qu’il rencontre, Sophie, celle-là même qui deviendra la mère de Laura, et que la proposition par les chatelains du coin de disposer d’un lieu plus porteur pour donner à voir la beauté enchante. Au départ, l’argent manque, mais l’engouement du voisinage pour le projet encourage, et déjà la ligne artistique se dessine : au grenier de Villâtre résolument ouvert à tous, les techniques et médiums se côtoient. Quarante-cinq ans plus tard, Laura et son époux Denis Durand sont restés fidèles à l’esprit d’un lieu où chacun doit se sentir libre d’entrer, et où l’artiste verrier et l’orfèvre sont regardés comme l’œuvre du peintre ou du sculpteur. Découverte d’une aventure familiale. Rencontre avec Laura Capazza-Durand.
/// Emma Noyant
Votre père avait la conviction que la culture était un outil fondamental d’évolution pour l’humanité. Comment en est-il venu à ouvrir en 1975 une galerie au cœur de la Sologne ? Dans un lieu qui, de fait, n’était a priori pas porteur…
Mon père avait été directeur de maison des jeunes de la culture (MJC) en région bordelaise. Assez vite, la mainmise politique sur la programmation culturelle ne lui a pas convenu. Il avait l’idée d’ouvrir un lieu destiné à tous les publics, avec liberté et indépendance. L’Hérault étant sa région d’origine, c’est assez spontanément qu’il y est revenu. Au départ, le grenier de Villâtre n’était pas porteur d’économies. C’était à la fois un succès d’estime et quelque chose qui n’était pas viable. Un notaire de Vierzon venu lui rendre visite manifesta un jour son vif intérêt pour sa démarche, et ajouta que le lieu n’était pas du tout propice au développement de l’entreprise. Mon père en avait bien conscience, mais il n’arrivait déjà pas à faire face aux 200 francs de loyer de cette petite bicoque, située dans un chemin sans issue, derrière une cage de carrossier. Le notaire s’est porté caution pour qu’il puisse acquérir une première maison dans le village de Nançay. Parmi les personnes qui se sont mises à fréquenter ce grenier, il y avait la fille du châtelain. Entre temps, il avait rencontré celle qui allait devenir ma mère, qui n’était autre que la petite sœur d’une des premières artistes ayant bien voulu lui confier ses œuvres. Avec la candeur de ses vingt ans, c’est elle qui l’a poussé à accepter la proposition a priori déraisonnable des châtelains d’investir leur espace. Nous sommes donc liés depuis 1978 par un bail siècle – manière pour les propriétaires de ne pas se déposséder entièrement du lieu, tout en le faisant vivre autrement. Nous avons ouvert en mars 1981.

Parmi les premiers artistes qui vous ont fait confiance, y a-t-il des artistes historiques qui sont encore là aujourd’hui ?
Oui, tout à fait. C’est le cas de François Righi et Patrick Jannin-Oms, ou de l’orfèvre Goudji, qui est aujourd’hui l’un des plus considérés sur le plan national. Pour la céramique, il y a eu des personnes comme Robert Deblander ou Claude Champy.
Vous avez repris les rênes du projet en 2015. Cela a-t-il toujours été une évidence pour vous que de vous joindre à cette entreprise ? Dans quelle mesure avez-vous investi l’espace de votre propre regard ?
Si nous sommes inscrits dans cette histoire mon mari et moi, c’est parce que nous nous sentions en phase avec le propos et le regard de mes parents. Tous les artistes que nous défendons aujourd’hui, ou presque, m’ont vue naître. Il y a donc un lieu affectif fort, mais aussi la construction d’un regard au fil des années. Cette histoire est comme la matérialisation d’une utopie. Aussi s’est-elle spontanément imposée, comme une évidence.
Pour ce qui est des évolutions notoires, nous avons ouvert le lieu à la photographie – pratique peut-être sous-représentée jusqu’à notre arrivée. Nous y avons accueilli une nouvelle génération d’artistes, tels que Jérémie Lenoir ou Eric Antoine.
Avec le principe de fidélité qui est le nôtre, nous montrons aujourd’hui 90 artistes permanents. Nous ne pouvons donc pas ouvrir nos portes de manière exponentielle. Pour pallier cette frustration du « non » perpétuel dû à un principe qui nous tient à cœur, nous avons lancé pour la première fois cette année un appel à candidatures, afin d’occuper notre espace le temps d’une exposition temporaire. Ces dernières années, nous avons également développé nos partenariats avec l’étranger (Shanghai) pour y montrer plusieurs de nos artistes. Enfin, il faut évoquer notre récent partenariat avec le musée Rodin, dans le cadre de l’exposition Jeanclos/Rodin.
C’est assez fantastique que de s’inscrire dans la continuité d’une aventure qui existe encore après quarante ans. De mon point de vue, cela sous-entend quelque chose quant au rapport que nous pouvons avoir aux artistes et aux amateurs/collectionneurs. Une histoire qui tient plusieurs décennies grâce à la sincérité qui la porte. Je ne pense pas que ce soit possible autrement.

L’éclectisme de vos choix est-il aussi dû à la situation géographique de la galerie ? C’est-à-dire à une volonté d’éducation. S’agit-il d’embrasser toutes les expressions artistiques pour en faire avant tout un lieu qui ouvre le regard ?
Nous souhaitons que ce lieu soit appréhendé comme étant le contraire d’un lieu élitiste. Certaines personnes n’osent pas en franchir la porte, du fait de son imposante architecture. Nous le regrettons, l’idée étant que les néophytes autant que les connaisseurs puissent apprécier le découvrir. En un sens, sa dimension patrimoniale est un avantage : l’on y rentre comme dans un musée ou un château. Souvent associé à l’art conceptuel, le mot « art contemporain » continue de faire peur : nous avons la volonté d’accompagner le public dans la découverte de ce que peut être la création contemporaine dans sa diversité. Au contraire, nous n’avons jamais estimé qu’il y ait une différenciation à opérer entre les arts dits « majeurs » et « mineurs ». Un objet tel qu’un bol en céramique peut être fonctionnel sans que cela ne dévalue sa valeur esthétique. Du fait de cette diversité que nous prônons, il est rare qu’une personne ressorte de la galerie sans avoir apprécié au moins un artiste. Il est aussi souvent arrivé qu’après une visite avec les étudiants, des professeurs nous écrivent que les plus réfractaires d’entre eux manifestaient une envie d’aller visiter un musée. C’est une victoire pour nous. L’histoire du lieu étant liée à la ruralité, tout le monde n’a pas tout de suite accès au sujet artistique. Nous avons par ailleurs conscience que notre situation géographique implique la démarche de venir jusqu’à nous. C’st pourquoi nous sommes présents sur les salons de manière régulière, afin d’aller à la rencontre du public.
Votre galerie a tout d’un espace muséal. Là où, du fait notamment des contraintes liées à l’espace, beaucoup de galeristes opèrent des accrochages « malheureux », sans mise en regard particulière entre les œuvres, vous cherchez quant à vous toujours à dégager des correspondances entre les talents que vous montrez…
Hélas, cette différence existe. Être galeriste, selon moi, c’est porter sur les œuvres un regard qu’il s’agit de partager. Le minimum est d’être à la hauteur de la confiance que nous accordent les artistes, par la mise en espace et en lumière. Aimer les œuvres, c’est avant tout les respecter. Nous sommes sensés mettre nos artistes en situation, afin d’être à même de les défendre. Le commissariat d’exposition fait partie intégrante de notre métier. Il faut aussi reconnaître qu’il est plus aisé de faire un bel accrochage lorsque l’on a 2 000 mètres carrés d’espace d’exposition…