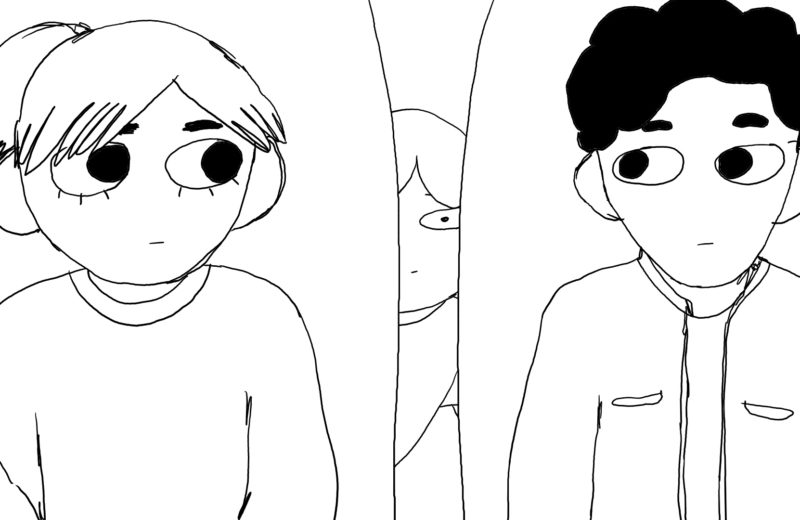Les marques ne peuvent plus êtres centrées sur elles-mêmes », affirment Didier et Sophie Guillon. Depuis 30 ans maintenant, le couple est aux commandes du prestigieux groupe Valmont : elle est responsable de la création des produits cosmétiques de luxe, il est en charge de la communication. Pour dépasser le microcosme du marché, ils choisissent d’établir un dialogue entre la marque et l’art, avec « philanthropie » pour mot d’ordre. Explications.
/// Emma Noyant
1. Vous êtes à la fois amateur d’art issu d’une famille d’artistes et de collectionneurs, et à la tête d’une grande maison de cosmétiques, dont vous êtes le directeur artistique. Comment cette passion pour l’art se manifeste-elle dans votre gestion du Groupe Valmont, dont la devise est « When Art meets Beauty » ?
Quand j’ai pris les rênes de l’entreprise il y a trente ans, il fallait que nous cherchions un moyen de nous différencier dans notre communication, par rapport aux marques de cosmétiques qui en général allaient chercher des mannequins ou actrices, pour en faire des icônes de promotion de leurs produits. J’ai toujours trouvé illogique qu’on prenne une très jolie femme et qu’au bout de cinq ans, on la remercie parce qu’elle a vieilli. Si on fait de la cosmétique anti-âge, on est supposé pouvoir la garder pendant trente ans. L’art m’est alors apparu comme un moyen intéressant de nous différencier des autres marques, sans doute parce qu’effectivement, cela fait partie de mon ADN familial. À l’époque, on faisait davantage de la communication visuelle fixe, avec des pages de publicité dans les journaux, ou dans les vitrines des magasins. Aujourd’hui, nous travaillons plutôt sur la notion d’immersion par l’image animée, bien que nous ayons toujours besoin d’images fixes. Le produit, c’est mon épouse Sophie Guillon qui en est le maître d’œuvre depuis bientôt 30 ans. Pour ma part, je suis en charge de l’aspect communicationnel : design des produits, conception des visuels… Cette année, j’ai entrepris de rendre hommage à des artistes que j’affectionne particulièrement : j’effectue un travail de réappropriation, je m’inspire de leur œuvre pour en transformer les couleurs. Les connaisseurs reconnaissent aisément l’artiste.
2. En 2015, vous créez la Fondation Valmont, dédiée à l’art contemporain. Quelle fut votre programmation lors des biennales de Venise 2015 et 2017 ? Quel était le propos de ces expositions ?
Le point de départ de tout cela, c’est en effet Venise. Nous avons acquis un très bel espace au Palazzo Bonvicini pour y présenter des expositions, en essayant humblement de nous faire une place au sein d’une ville ayant une programmation culturelle si riche, et dont les artistes viennent du monde entier. Ces expositions sont toujours collectives, je ne suis jamais seul à exposer. Ce qui me plaît, c’est cette notion d’atelier collectif avec des artistes que je réunis en Grèce, dans un esprit un peu Montparnasse : au début du XXème siècle, Braque, Picasso, Giacometti se retrouvaient pour travailler, ce que nous avons perdu aujourd’hui. Or c’est par l’échange qu’ils arrivaient à créer des œuvres si extraordinaires. À un échelon plus modeste, ces ateliers au sein desquels nous nous retrouvons à trois avec des curateurs nous permettent de débattre des prochaines expositions. En 2015, la programmation était en lien à la matière issue de feu : le verre et la céramique. Il y avait donc un collectif d’artistes, constitué de la famille de céramistes Artigas, d’une part, et de l’autre d’une artiste new-yorkaise et d’un vénitien, qui travaillaient plutôt le verre. En 2017, le sujet était Beauty and The Beast, premier volet de la trilogie des contes de fées, avec Quentin Garel et cette artiste new-yorkaise travaillant le verre. Nous avons choisi le thème du conte de fées car il révèle l’opposition entre le bien et le mal. Cette année, l’exposition s’intitule Hansel and Gretel. L’idée, c’est de se questionner sur notre manière de retrouver notre chemin en tant qu’adultes, dans les métropoles dans lesquelles nous évoluons, ce qui semble de plus en plus complexe. Nous donnons donc des petits cailloux blancs comme dans le Petit Poucet aux visiteurs, pour les interpeller sur le fait qu’il faille songer à renouer avec leur humanité. Ma partie de l’exposition s’intitule White Mirror, et est destinée à voyager. Enfin, le titre de la Biennale de 2021 est Alice in Thunderland; « thund » signifiant « abandonner » en anglais. Là encore, on travaille sur la notion d’un monde abandonné dans lequel il faut recréer notre chemin.

3. Quelle est la portée humanitaire de vos expositions ?
Ces expositions sont systématiquement détruites et donc construites en matériaux recyclables : il s’agit pour moi d’un outil de sincérité. De plus, je ne vends que pour reverser des fonds à des association caritatives. Lorsque nous avons présenté White Mirror à New-York, c’était en partenariat avec l’association Publicolor, qui aide des jeunes de la rue à se réinsérer socialement, grâce à l’art. Publicolor, ce sont des évènements très ciblés qui nous permettent, entre autres, d’offrir à un groupe de jeunes la possibilité de venir à Venise en 2021, pour y installer leurs créations. En ce moment, nous sommes beaucoup dans cette relation philanthropique avec des associations destinées aux enfants. L’art est un outil magnifique pour les sortir de leur quotidien. L’entreprise gagne de l’argent en vendant des produits, mais doit aussi en reverser une partie sous forme de dons à des associations avec lesquelles nous sommes en phase.

4. Ces expositions véhiculent parfois un propos qu’on peut qualifier d’engagé, qu’en est-il ?
Quand l’exposition White Mirror voyage en dehors du Palazzo Bonvicini, qu’elle va à New-York ou à Tokyo, nous vendons des produits, afin de récolter des fonds pour ces associations. Pour faire le lien entre l’art et le luxe, j’ai transformé quelques éléments de l’exposition de Munich : c’est une forêt de totems sur lesquels il y a des masques blancs. À Tokyo et à New-York, certains masques ne sont plus blancs mais dorés, pour faire un lien avec l’univers du luxe. Mon propos, c’est aussi d’attirer l’attention des gens en leur disant que certes, on a besoin de tels objets pour rêver à l’inaccessible, mais qu’il ne faut pas oublier que pour certaines personnes, même rêver est un luxe inaccessible. Les personnes en difficulté, que je regroupe sous le terme « migrants », je les symbolise par des boules dorées que je place entre les arbres : je veux dire par là qu’il ne faut pas les oublier. C’est aussi une manière de dire à mes enfants que si un jour ils sont riches, ils doivent se souvenir d’une chose : Il ne faut pas être cité comme le plus riche, mais comme le plus généreux.
5. Vous offrez une visibilité sur l’art qui dépasse le lieu d’exposition traditionnel, en exposant des œuvres dans des spas de palaces, grands magasins partenaires ou jolies parfumeries…
Les premiers, les japonais ont utilisé les grands magasins comme espaces d’exposition. Le Bon Marché s’est engagé lui aussi dans cette voie, en faisant de très beaux accrochages. Ces endroits sont situés dans les quartiers les plus fréquentés. Pour vous donner un exemple, White Mirror a attiré dans le plus grand magasin de Tokyo quelques 18000 visiteurs : la plus belle des galeries sur rue ne m’apportera pas cette fréquentation. Je pars bientôt à Milan, pour une très belle exposition dans une galerie de la Brera, le quartier du design : je n’aurai pas 18000 visiteurs. Tout dépend de l’intérêt du grand magasin quant au fait de s’ouvrir à autre chose que la vente du produit. C’était le cas à Tokyo, cela le sera à Hong-Kong, mais cela ne l’est pas toujours. White Mirror (et les autres expositions) vont donc dans les grands magasins, les galeries et les maisons Valmont : l’exposition est en ce moment à Munich, nous y avons une boutique sur Maximilien Strasse. Elle sera aussi en Chine à la fin du mois et à Milan, à la galerie Cardi pendant sept jours.

6. Vous avez une passion particulière pour le verre de Murano et menez des collaborations en ce sens. Souhaitez-vous poursuivre dans cette voie ? Quels sont vos projets ?
Dans la boutique qui ouvrira en avril rue de Castiglione à Paris, les visiteurs verront un lustre magnifique des ateliers d’Aristide Najean : ce sera la pièce maîtresse de la boutique. Je vais bien sûr continuer à travailler avec les gens de Murano. J’ai entre autres une collaboration avec un talentueux verrier qui s’appelle Leonardo Cimolin, avec lequel j’ai fait les masques de la collection Storie Veneziane, visible au Bon Marché.
7. Quels sont les mouvements artistiques et artistes qui vous influencent dans votre travail ?
Mon premier choc esthétique remonte à l’année 1971, quand mon père m’emmène voir la première rétrospective Bacon au Grand-Palais. Mon père me faisait régulièrement visiter des musées : il m’a fait découvrir des artistes aussi différents que Tàpies ou Roberto Matta. Néanmoins, ce ne sont pas eux qui m’ont inspiré : c’est plutôt la génération des minimalistes américains. Les cubes de Sol LeWitt, Carl Andre, Dan Flavin… Du côté de ma mère, j’ai une famille de marchands de tableaux, de sculpteurs et collectionneurs qui accumulaient les œuvres sur les murs, comme cela se faisait à une certaine époque. C’était un peu le musée du Louvre, on ne parvenait plus vraiment à identifier une toile au milieu d’un amoncellement de tableaux, dont l’accrochage était souvent incohérent. C’était donc une sorte de rébellion que d’aller vers ces artistes : je cherchais non pas une dimension esthétique mais l’essence même de la matière, de l’objet et de l’inspiration. C’était d’autant plus une rébellion car mon arrière-arrière-grand-père Charles Sedelmeyer était un grand marchand de tableaux du début du XXème siècle, qui a notamment eu l’Angélus de Millet entre les mains, et a vendu des œuvres aux grands industriels américains qui se constituaient alors leur collection. C’était du Rembrandt, du Rubens, toutes les écoles anglaises du XVIème, XVIIème et XVIIIème siècle.
8. En tant que collectionneur, quel est le fil conducteur de vos acquisitions ?
Je marche au coup de foudre. Je ne me renseigne jamais sur les côtes pour savoir qui a pris de la valeur, je m’intéresse aux artistes et noue des relations personnelles. Ce sont des personnes avec lesquelles à un moment donné, je souhaite monter une exposition à Venise. C’est la rencontre avec un artiste qui prime, et l’envie de faire quelque chose avec lui. Par exemple le sculpteur Quentin Garel, avec lequel j’ai fait une Biennale à Venise. J’ai aussi de très beaux dessins de Sol LeWitt, qui a nous quitté il y a quelques années.