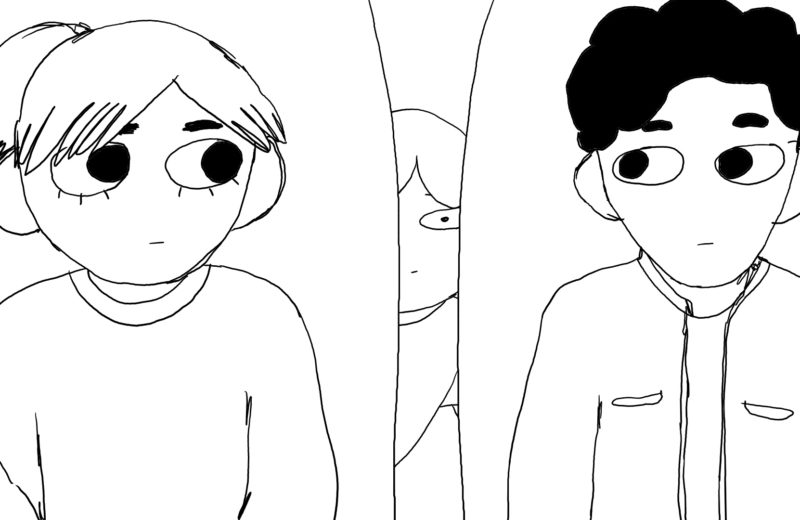Faut-il encore présenter Garouste ? Ce conteur en peinture n’ayant de cesse de scruter mythes et figures qui, un jour, a voulu faire partager son expérience salvatrice de l’art au plus grand nombre. Dans les pages qui suivent, nous avons échangé avec lui autour de son processus créatif, de ses références, et de la part d’intime et d’altérité dans ses toiles. Il est aussi question de ce qui a déclenché, chez lui, l’envie de peindre, puis celle de « faire peindre » en ouvrant, dès 1991, l’association La Source.
/// Emma Noyant

1. Vous semblez particulièrement attaché à la représentation des mythes et grands textes religieux et profanes. Vos influences sont, semble-t-il, plus littéraires que picturales. D’où vient ce besoin de mettre des images sur les mots ?
Je suis effectivement intéressé par les contes, fables, légendes et mythes… Pour ce qui est des textes religieux, qu’ils appartiennent à l’Egypte ancienne, à la Grèce ou qu’il s’agisse de la Bible, ce ne sont pas pour moi des textes religieux, mais des mythes. Mon sujet, d’une façon générale, ce sont les mythes. Ayant étudié l’hébreu, ceux que j’aborde sont gréco-latins et hébreux. En touchant aux mythes universels, mon idée est d’être au plus profond de thèmes qui me sont très personnels, mais aussi d’aller au plus profond de l’autre, de celui qui regarde. Mon rapport au public, au visiteur ou au collectionneur, rejoint l’idée de Roland Barthes au sujet de la mort de l’artiste : tant que l’œuvre est dans mon atelier, elle m’appartient, j’y mets tout ce que je veux y mettre, mais dès qu’elle en sort, elle est à celui qui la regarde. Le tableau voyage de regard en regard, chacun en a son interprétation. C’est aussi ce que je retiens des mythes : chacun se les approprie. À travers une lecture, dix mille interprétations sont possibles, et à chacun sa vérité.
2. Avant cette appropriation de l’œuvre de la part du regardeur à la sortie de l’atelier, la peinture n’est-elle pas l’espace de liberté par excellence ? L’intranquille, qui est à la fois un autoportrait bouleversant et une réflexion sur les enjeux de l’art, semble clairement l’énoncer…
Oui, vous avez tout à fait raison : mais cette liberté a une limite. La liberté, pour moi, est limitée à un cadre avec une toile tendue dessus. C’est un petit espace qui présente des contraintes matérielles ; à moi d’exprimer ma liberté dans quelque chose de très réduit. L’espace d’une prison est un très bon lieu pour rêver sur la liberté : une toile tendue sur châssis dans un atelier très agréable, c’est une manière de définir l’espace de sa liberté.
3. Outre la délimitation du cadre, vous vous imposez aussi des règles. Vous semblez toujours travailler par série autour d’un thème ?
Oui, en effet. En ce moment je travaille sur Kafka. Enfin, je n’aime pas le mot « travailler », c’est un mot d’artiste conceptuel, qui manque sérieusement de poésie. Cela étant dit, si je vous disais, je poétise sur tel ou tel tableau, vous pourriez rire. Je suis donc préoccupé par Kafka depuis deux ans. Tout le monde connaît Kafka : c’est intéressant d’en donner sa version personnelle, car les gens ne sont pas perdus. Je fais toujours avec ma culture. Et si mon domaine, c’est l’image, il est assez intéressant, je crois, de montrer qu’elle peut soudainement apporter un tout autre sens à un texte écrit.
4. Vous parlez d’universalité. Or, parmi les éléments stylistiques réitératifs dans vos toiles, on voit tout un bestiaire. La mobilisation de ces animaux ne participe-t-elle pas de cette affiliation de l’accès à la toile, de cette universalité en question ?
Bien sûr, parce que les animaux font tout de suite référence à tel ou tel autre caractère. Cependant, ce qui est intéressant, c’est que les animaux de la Fontaine appartiennent au contexte d’une culture gréco-latine. On retrouve chez La Fontaine des textes d’Ésope : les animaux représentent des caractères humains. Le renard et le singe sont malins, l’âne porte des fardeaux dont il n’a pas même connaissance, il est un benêt un peu nigaud. Le lion a la force, il est le roi des animaux. Tous les caractères de la société sont représentés à travers ces animaux. Or, dans l’ancien testament écrit en hébreu et non en gréco-latin, ce sont les mots qui ont plus d’importance que les symboles qu’ils véhiculent. L’âne a une grande importance dans la pensée biblique : le Messie Jésus est porté par un âne lorsqu’il arrive à Jérusalem, ce qui renvoie à l’esprit dominant la matière. L’âne représente donc la matière et non le serviteur. Vous savez, l’âne a des grandes oreilles au sens d’écouter, et donc d’entendre. Dans mes tableaux, il n’est donc pas du tout celui de La Fontaine, mais plutôt celui de L’Ancien Testament. Les animaux de Kafka sont aussi pris non pas pour ce qu’ils évoquent, mais par rapport aux racines des mots, aux jeux de mots exprimés dans d’autres langues.

5. Vous travaillez à partir de croquis préparatoires… Quelle est la place laissée à l’imprévu dans vos tableaux ?
C’est justement l’imprévu total. J’ai tout le temps sur moi un carnet. Pour prendre un exemple célèbre, nous connaissons tous l’histoire d’Archimède prenant son bain, trouvant soudainement la solution, sautant de son baquet parce qu’il a enfin résolu sa préoccupation constante, et criant : « Eurêka! » On vit tous ce genre de choses. J’ai les animaux de Kafka dans la tête et soudainement, en conduisant, un chien va traverser devant moi à un feu rouge. Une idée va alors me venir et je vais vite m’arrêter pour la noter. Les meilleures idées viennent tout à fait par hasard, mais elles sont toujours reliées à des thèmes précis. Si je suis sur Kafka, je ne suis pas sur autre chose. Pendant un an, deux ou trois, toutes mes préoccupations vont tourner autour de ce thème.

6. Vous créez La Source en 1991, association ayant pour but d’aider les enfants à développer leur potentiel créatif. Surtout, transparaît dans ce projet une ambition de l’ordre du social, comme si l’art devenait en fait un outil. Vous dites que le mot clé, c’est « la transmission »…
Oui, et c’est d’ailleurs un peu le propos d’une œuvre d’art en général. Quand un poète écrit un poème, son but est de le faire lire, de le transmettre, le partager. Quand je fais une exposition dans une galerie, c’est pour transmettre quelque chose. À La Source, l’idée de s’adresser aux enfants prend du sens. On ne veut pas en faire des artistes, mais leur faire comprendre que la dimension artistique donne la liberté. On peut bien sur être libre sans avoir besoin de créer. Mais un artiste, c’est souvent quelqu’un qui éprouve un manque quelque part, et ce besoin se traduit par une œuvre, par la nécessité de communiquer. La Source entend inculquer le sens de la liberté et de la responsabilité par l’activité. La liberté, ce n’est pas quelque chose qu’il faut demander, mais prendre. Et si l’art permet a l’enfant d’acquérir cette liberté, il pourra s’en servir pour autre chose, son bien-être, ses opinions… L’art, c’est se balader dans une forêt, c’est discuter avec un artiste ou chanter. Il s’agit de transmettre une attitude, une manière d’être dans la vie. On fait de l’art un outil, un vocabulaire pour transmettre ce rapport au monde.
7. Je rebondis sur cette idée de « prendre la liberté par l’art » : vous même, l’art vous a sauvé. Ce choix se rapporte à votre trajectoire personnelle, à votre propre enfance, et au fait que l’art ait été pour vous un élément salvateur, dont vous montrez à votre tour la force rédemptrice. Vous êtes en quelque sorte un passeur…
Malgré cet avantage qui m’a été donné d’être dans une école classique, j’avais de grosses difficultés, y compris psychologiques. J’étais en échec, dyslexique qui plus est. La peinture m’a donné une identité : le seul moment où j’existais un peu pour mes camarades et les adultes, c’était lorsque je prenais un crayon. Je me consacrais plus au dessin qu’aux dictées. J’aurais voulu être architecte, médecin… Mon rêve, c’était d’être entomologiste, mais je n’ai jamais passé le moindre examen. Le dessin m’a toujours sauvé. Sans doute est-ce pour ça que dans mes tableaux, les personnages ont de grandes mains : je fais bien plus confiance à mes mains qu’à ma tête.
8. Concernant ce parcours scolaire, vous êtes passé par l’Ecole des beaux-arts, voie royale qui, selon vous, ne vous a rien appris. Ce projet La Source n’induit-il pas de fait votre vision de l’apprentissage de l’art, qui consisterait en une histoire qu’on apprend à l’école, mais une pratique qui ne s’apprendrait pas à l’école ?
L’Académie des beaux-arts a peut-être eu un sens jusqu’au 19ème siècle. On apprenait le métier de peintre, comme on apprend encore aujourd’hui la musique dans un conservatoire de musique. Mon rêve en allant aux beaux-arts, c’était d’apprendre à peindre. Or personne n’y apprend plus à peindre, aujourd’hui. J’étais dans l’atelier d’un abstrait, il jetait du riz sur la toile, faisait des inventions de ce type… Pourquoi pas, mais j’aurais voulu apprendre avec des professeurs, pas des génies. On est génial après un enseignement, ce n’est pas à l’école qu’on apprend le génie. Je vois La Source comme un complément à ce qu’il se passe à l’école, qui est absolument nécessaire. L’école est bien sûr un lieu de transmission : un professeur transmet son savoir. Cependant, je dirais qu’à l’école, ça ne va que dans un sens. À La Source, au contraire, l’enfant a une relation avec l’artiste. Celui-ci va lui apprendre comment il procède de la création, lui transmettre sa manière de voir le monde. Ensuite, l’enfant va tout de suite créer, faire une œuvre collective, s’exprimer. C’est un échange : le professeur donne, mais l’enfant aussi. Chose qu’on ne peut pas faire à l’école, compte tenu du nombre d’élèves par classe. À La Source, l’éducateur est là pour gérer l’ensemble des enfants, et l’artiste pour communiquer personnellement avec chacun. Tout est possible, sans note et sans code. Chaque artiste a son attitude : l’un va se balader dans les bois pour faire des sculptures avec du bois, Combas fait des sculptures à partir de choses trouvées dans les poubelles. Il y a cette liberté totale. Et c’est toujours très ludique, il faut que ça le soit.
9. Passons enfin de l’Ecole des beaux-arts à l’Académie des beaux-arts. Vous avez été élu membre de l’Académie en décembre 2017. Que pouvez-vous nous en dire ?
L’Académie des beaux-arts est en train de changer. Quand j’étais étudiant aux beaux-arts, elle avait très mauvaise réputation, car Malraux l’avait punie. Entre autres, il avait supprimé la villa Médicis pour la donner à l’état, estimant qu’il s’agissait d’un trop beau lieu. L’Académie des beaux-arts donne des prix à des artistes, elle a le musée Marmottan, le musée Claude Monet de Giverny… Quand j’avais une trentaine d’années, on m’avait déjà proposé de rejoindre l’Académie. J’ai refusé, car l’époque était trop empreinte de cette citation de Malraux selon laquelle il ne fallait pas y mettre les pieds. Aujourd’hui, cela a changé. Nous avons la chance d’avoir Laurent Petitgirard, musicien et secrétaire perpétuel, qui fait rentrer d’excellents artistes comme Fabrice Hybert. Travailler avec eux va nous permettre de soutenir la jeune création et de donner une nouvelle image de l’Académie. Il faut rappeler que L’Institut de France, c’est la France en dehors des collections privées. L’Académie des beaux-arts est libre et indépendante y compris de l’État, bien que nous soyons bien sûr en relation avec lui. Ce sont les artistes, et seulement eux, qui décident entre eux. Il y a du travail à faire afin que certaines structures changent, notamment le système des votes. Mais si je n’y suis rentré qu’en 2017 alors qu’on me le proposait depuis un certain temps déjà, c’est que j’estime qu’aujourd’hui, il y a beaucoup d’avenir du côté de l’Académie.

« La liberté, pour moi, est limitée à un cadre avec une toile tendue dessus. »